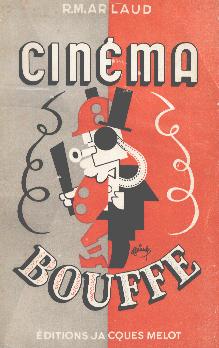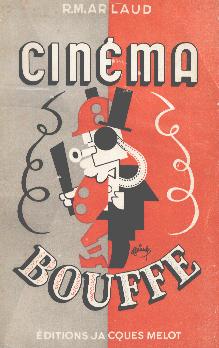
A PROPOS DE L'INCENDIE DU BAZAR DE LA CHARITE.
CINÉMA-BOUFFE de Rodolphe-Maurice ARLAUD – Editions Jacques Melot
(1945)
(voir couverture en fin de texte)
(CHAPITRE IV)
DRAMES ET BOUFFONNERIES
Répondant aux détracteurs du cinéma, Coissac*
invoqua une maladie grave qui atteint l'enfant-fée (le cinéma)
dans ses toutes premières années : le Bazar de la charité.
Cette maladie faillit, en effet, lui coûter la vie. Il risqua fort,
tout comme le Cineorama de Grimoin-Sanson en 1900, d'être rayé
d'un trait de plume. Nul ne saurait dire alors quand et comment il en serait
sorti ni même s'il en aurait réchappé. Il ne servirait
à rien de le nier à l'heure actuelle, c'est bien le cinéma
qui provoqua une des plus belles et plus spectaculaires catastrophes civiles
des temps présents. (Dans d'autres domaines, on a fait infiniment
mieux mais pareil propos est absolument hors de propos…)
Le cinéma avait deux ans. C'était un beau bébé.
Les salles poussaient comme perce-neige au premier soleil et par un hasard
assez inexplicable, les installations sommaires des cabines (le terme est
un peu anticipé) n’avaient néanmoins jamais mis le feu aux
établissements.
Il n'y avait plus de fête, plus de manifestation sans une ou
plusieurs attractions cinématographiques et le Bazar de la Charité
se devait de ne pas manquer à la règle.
Il eut donc son cinéma, un cinéma permanent qui déroulait
son ruban de Celluloïd dès l’ouverture et jusqu’à la
dernière minute.
Tout était bien préparé pour un magnifique incendie.
Ceux qui ont tant de mal à allumer le moindre poêle auraient
pu venir y prendre des leçons : constructions en bois léger,
tentures de gaze et enfin un splendide vélum couvrant le tout.
Pour plus de certitude, on avait choisi l'appareil de cinéma
le plus dangereux, le projecteur oxy-éthérique fonctionnant
à vapeur d’éther.
Au bout de quelques heures de projection, l’opérateur voulut
recharger sa lampe. Elle était brûlante. L'éther fit
instantanément explosion. Le film déroulé était
en tas par terre, les bobines enrouleuses n’existaient pas encore. La pellicule
s'enflamma immédiatement, se tordit en serpent de feu, les tentures
s’embrasèrent, le vélum fut léché d'une flamme
immense et s'abattit. Affolement, panique, brutalités, victimes
et ce qui aggrava le cas, victimes importantes appartenant à la
plus haute société parisienne. Le Bazar de la Charité
fut la providence des journalistes et des avocats. Les responsables étaient
nombreux et difficiles à disculper; il fallait orienter la vindicte
publique et trouver un grand coupable.
Nul mieux que le cinéma ne se prêtait à ce rôle.
On. demanda son exécution. On fut près de l'obtenir. Le préfet
d'alors se souciait peu de progrès; l'essentiel était de
calmer les esprits. La mesure d’interdiction eût été,
elle aussi, spectaculaire. Le décret n'attendait plus que la signature.
Gros émoi chez les cinéastes. Tous firent bloc. Méliès,
Pathé, Gaumont, les Lumière même.
On essaya de faire jouer le doute, d'inculper la cuisine, un fumeur;
on envoya des délégations; on fit jouer des influences; on
provoqua des campagnes de presse. On ne put rien prouver et pour cause,
mais on parvint à tout embrouiller, à créer un doute;
le cinéma n'était pas justifié, il ne bénéficiait
même pas des circonstances atténuantes, il avait tout juste
un sursis. Il était sauvé. Officiellement sauvé, mais
gravement atteint. Immédiatement le public s'abstint. Les hurlements
de la presse ne sont jamais tout à fait inoffensifs. L'encre de
journal salit toujours les doigts.
Personne ne s'était jusqu'alors intéressé à
la technique du cinéma, au principe du film, à sa matière
et voici qu'à colonnes pleines, on explique que la bande magique
a la même composition chimique que le plus redoutable explosif, que
la flamme nue est le principe vital de la projection, que la simple chaleur
produite peut allumer le film si par malheur celui-ci s'arrête une
seule seconde, que c'est miracle si l’incendie n’accompagne pas ponctuellement
chaque séance de projection !
La contrepartie, les explications, une certaine logique ne pouvaient
servir à rien, la peur était venue.
Cet amusement pour enfants était devenu croque-mitaine. Les
recettes baissèrent, un certain nombre de montreurs d'images renoncèrent
et crurent bien sincèrement à la fin d'un enthousiasme passager.
Ce fut un très réel coup de frein. Cette situation dura jusqu'à
l'Exposition de 1900. Pour combler la mesure, les salles qui jusqu'alors
ne brûlaient pas, devinrent de vrais feux de joie, un peu partout
à travers la France le cinéma alimentait la chronique du
feu.
On peut attribuer cette soudaine incandescence aux nouveaux arrivants.
Les premiers opérateurs n’étaient pas des tourneurs de manivelle,
mais bien des gens aimant leur métier et l'exerçant comme
une sorte de sacerdoce. Les autres commencèrent à prendre
la marque du métier : l'irresponsabilité.
Le fait que les ambulants ne brûlaient pas confirme le fait.
Les ambulants savaient le danger permanent; ils furent les premiers à
s'organiser.
Ils ont créé les précautions essentielles, préventives.
La première méthode était celle de la bâche.
Une énorme toile longuement trempée dans l’eau avant la séance
était posée en permanence à côté de l’appareil.
Lorsque le film s'enflammait on couvrait tout avec la bâche. C'était
irrésistible le projecteur ne s'en sortait pas toujours indemne,
mais le feu n’insistait jamais. La seconde méthode était
moins radicale mais sauvegardait le matériel. On avait un sac mouillé
plein de suie humide. Au premier « coup de feu » on arrachait
la bobine et on la précipitait dans le sac. Les forains, dont les
films rapiécés bloquaient les engrenages et brûlaient
bien trois ou quatre fois par séance, étaient partisans du
sac. L'opérateur n'en sortait pas toujours à bon compte.
Il y eut bon nombre de mains sacrifiées pour la religion nouvelle.
« C’est le métier qui entre », disaient philosophiquement
ceux qui n’étaient pas à la projection.
... Le feu fit s’amplifier la méfiance que, tout naturellement,
le cinéma rencontrait au fur et à mesure de ses conquêtes
nouvelles. Ce que le préfet de Paris n'avait quand même pas
osé faire, des municipalités, n’hésitèrent
pas à le réaliser fièrement. On vit dans certains
champs de foire de petites pancartes : « Il est interdit d’installer
des jeux dangereux et de faire du cinéma. » Par contre, les
salles de patronage, comprenant la concurrence commencèrent à
s’équiper, d'autant plus que les « éditeurs »
devançant leurs désirs, s'étaient mis sans retard
à sortir des films religieux. Ces salles-là s'établirent
rapidement en tête de liste sur le palmarès du feu. Les appareils,
confiés souvent à des enfants débrouillards, devinrent
de très réels dangers. L'incendie du patronage d'Avignon,
avec sa dizaine de victimes, fut une des démonstration les mieux
réussies.
On projetait par transparence; l’appareil était sur la scène
au milieu d'un décor en papier. Afin de ne courir aucun risque,
on avait fait venir un spécialiste de cette exploitation qui se
louait, lui, son matériel et son programme. Au premier « coup
de feu », il s'affala, abandonna tout et se précipita à
la sortie en criant « au feu ! » ; la panique devança
l'incendie. C’est par chance qu'il y eut des rescapés; il ne resta
rien de la salle.
Les techniciens voyant arriver la fin précoce de leur métier
s’ingénièrent à trouver le film ininflammable.
En dépit de plusieurs découvertes, il n'est pas encore
actuellement, utilisable en grande exploitation.
Petit à petit, après 1900, dans les villes où
la chronique des pompiers ne signalait pas de cinéma depuis suffisamment
longtemps, les spectateurs revinrent. Ils se sentaient des âmes de
héros et les places les plus recherchées étaient celles
qui entouraient la porte. Par voie de conséquence commerciale,
elles augmentèrent de prix. La loi de la demande est sacrée
! L'apaisement vint surtout de la généralisation de la cabine.
Au début, ce fut une boite de tôle où l'on enfermait
matériel et personnel. La cabine avait également l'avantage
d'étouffer les bruits de la mécanique que le piano ne couvrait
pas toujours.
On en vint alors à la formule actuelle; l'opérateur maladroit
se faisait proprement brûler mais le public pouvait ne s'apercevoir
de rien. Cette hantise du feu provoqua pourtant encore des victimes dans
le Jura, en 1905, alors que tout se passait normalement. Le film représentait...
un incendie. Un bébé dormait dans son berceau, une lampe
à pétrole était renversée par un coup de vent,
la fumée obscurcissait l’écran et soudain, une flamme jaillissait.
Elle avait beau être noire et blanche; cette flamme, elle avait beau
avoir l’allure saccadée des films de l’époque, le pouvoir
de suggestion de l'écran ,était tel, sur ce public tout neuf,
que la salle entière se leva brusquement, se précipitant
vers la sortie, renversant les chaises. Il y eut quatre morts. Il fut dorénavant
interdit d'imager des incendies.
Petit à petit, les Pouvoirs publics intervenant de plus en plus
dans le métier du cinéma, s'intéressèrent à
« la sécurité du public ». Profitant des expériences
des uns, des idées saugrenues des autres, s'édifia un des
beaux monuments de comique involontaire : le règlement de sécurité
encore actuellement en application dans les salles. Ce règlement,
inspiration d'un capitaine de pompiers bouffon, ne tient aucun compte du
progrès, qu'il s'agisse de garantie nouvelle ou de dangers nouveaux.
Le règlement de sécurité protège les salles
en mesurant en centimètres la largeur des sorties. Par contre, il
n'interdit pas les cabines à l'intérieur de l'établissement,
ce qui constitue un réel danger pour l'opérateur. II y eut
pourtant, parmi tant d’autres, une belle démonstration faite en
1936, dans une ville du Midi. Les opérateurs étaient obligés
de traverser la salle pour aller à leurs appareils. Pour des raisons
imprécises, un seul était en cabine ; le film s'enflamma.
La cabine était en désordre une pellicule traînait
au sol, elle fit mèche transporta le feu au coffre où étaient
rangées les autres bobines en moins d'une minute la cabine était
un brasier et le maladroit une torche..., une torche qui voulut s'échapper
à travers la salle, trouva la porte fermée à clé,
réussit à crever le plafond, brisa une verrière...
On découvrit plus tard son cadavre dans une petite cour de l'immeuble.
Une enquête fut ouverte au sujet de ce malencontreux tour de clé
qui, en condamnant l’opérateur, sauva la salle et le public. II
fut établi que le directeur avait pu, par les fenêtres de
projection, suivre le drame... On préféra supposer une vengeance
d’ouvreuse, une affaire de jalousie; on termina par un non-lieu. Quelques
années plus tard, le directeur répondait à un confrère
qui lui disait tout à trac : « Le tour de clé, c'était
vous ? -- Qu'auriez-vous fait à ma place ? » En fait, il avait
raison; mais le règlement de sécurité autorise toujours
les cabines dans les salles.
Il exige, par contre, un siphon à côté de chaque
projecteur parce qu'un opérateur débrouillard s'en servit
une fois avec bonheur. Le pompier de service ne vérifiera jamais
si les extincteurs sont en état de marche mais ne manquera jamais
de secouer le siphon. Que l'on invente des appareils de sécurité
perfectionnés... On demandera le siphon.
On n'a jamais exigé du directeur et du personnel des salles
une consigne de feu avec répétition, pour que chacun sache
ce qu'il doit faire..., mais on cherchera noise à l’électricien
de service et l'on voudra voir en cabine un seau d'eau plein, recouvert
d'une couverture sèche... en cas de feu, on immerge la couverture
et quand elle est bien gorgée d'eau on couvre la flamme, s'il reste
encore quelque chose à couvrir. D'ailleurs, pour l'amusement de
chacun, mieux vaudrait citer, tout simplement.
Seulement, où irait-on, si l'on se mettait à citer les
textes administratifs ! Le papier est encore si rare !
*L'auteur fait allusion à Georges-Michel Coissac qui a écrit
"Histoire du cinématographe de ses origines à nos jours"
(1925) Préface de J.-L. Breton; et "Les coulisses du Cinéma"
(1929)